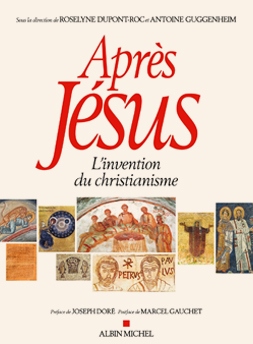
Après Jésus
L’invention du christianisme
Roselyne Dupont-Roc et Antoine Guggenheil (dir.)
Albin Michel, Paris, 2020,
704 p., 49 €
140 pages plus court que Jésus, l’encyclopédie laissent cet ouvrage sans jalousie face à son aîné, avec 84 auteurs de renom. Si le lecteur réussit à prendre sa distance vis-à-vis de la mode des idées qui passent, il trouvera une source d’in- formations rigoureuses et une offre de parcours, de la première à la dernière page survolant les années des temps apostoliques aux années 250 et un peu au-delà.
Le Livre I, « Des racines et des textes » expose les commencements, les écrits, les témoins historiques, l’archéologie, par et au milieu d’autres cultures, le monde juif et la création d’un judaïsme post-chrétien, le sacré et le profane de ce temps, le monde romain. Le Livre II, « Querelles d’héritage » se pose la question du repas du Seigneur et de la fabrique des rites dans les premières assemblées, met Paul en débat, comme homme, apôtre et théologien, reprend le dossier de la sépa- ration douloureuse d’avec la synagogue et finit sur le développement du mystère de l’identité du Christ. Le livre III,
« Vers l’Église » commence par le réseau des maisons de chrétiens, l’effervescence intellectuelle pour rendre compte de la foi et une dernière partie avec quelques répétitions sur la géographie de l’Église. Cette histoire primitive valorise les quelques générations qui ont « inventé » le christianisme des origines et nous permet de mesurer leur créativité, pour incarner concrètement une voie spi- rituelle. Nos aînés ont fait grandir ce qu’ils avaient reçu. Et si nous devons à notre tour les imiter, jucher sur leurs épaules, c’est pour aller plus haut. Ainsi, déconstruire l’eucharistie en raison d’une analyse clinique peut mener à la ruine. Cependant, la dimension temporelle de cette construction, de même que, sur un autre registre, la personnalité singulière de Paul nous disent quelque chose de la manière de maintenir une religion chrétienne vivifiante, alerte, dynamique. Il s’agit de rendre compte de l’édification du corps de l’Église sur la terre, ses institutions et sa doctrine afin de poursuivre le chemin.
Citons un échantillonnage d’auteurs. Le rabbin Rivon Krygier est excellent dans sa critique d’une lecture anti-judaïque de Paul, faisant écho à un autre article sur la justification, et Michel Fédou est formidable, comme sur l’écrit À Diognète, décrivant la situation politique des chré- tiens dans une dialectique patrie/terre étrangère. Antoine Guggenheim précise la question des théologies malheureuses de la substitution entre Israël et l’Église ; Marc Rastoin étudie la nomination de Jésus par les synoptiques et le développement de la figure du Christ comme membre d’une fratrie à l’instar de Juda et ses frères faisant de Jésus la figure d’un homme auquel l’évangéliste attribue des frères qui nous placent tous sous le regard d’un Père, comme le souligne Chantal Reynier. L’attention aux enfants en souffrance pour lesquels les chrétiens ont innové se résume à un bilan contras- té selon Sabine Armani, nous évitant de situer ceux-ci hors-sol de leur temps. Il est rappelé en plusieurs endroits l’émergence ferme de l’Église romaine, avec un des tout premiers gestes d’autorité absolue par Étienne (254-257) affirmant la validité du baptême reçu par une communauté dissidente, première pierre irréversible de l’œcuménisme.
Ce livre est un outil d’intelligibilité. Son but vise certainement un ajustement aux réalités sans affadir une sensibilité à cette vie humaine vivifiée par le vent de l’Esprit, insaisissable. Après Jésus, goûtons au jardin de son œuvre et re- connaissons les signes d’un phénomène historique et social étonnant.
Emmanuel de Clercq
Rédacteur en chef adjoint de la revue Prêtres Diocésains, membre du comité de Rédaction, employé de banque, auteur d'un livre "La force du don - La gratuité en question" aux éditions Saint-Léger (2022)
